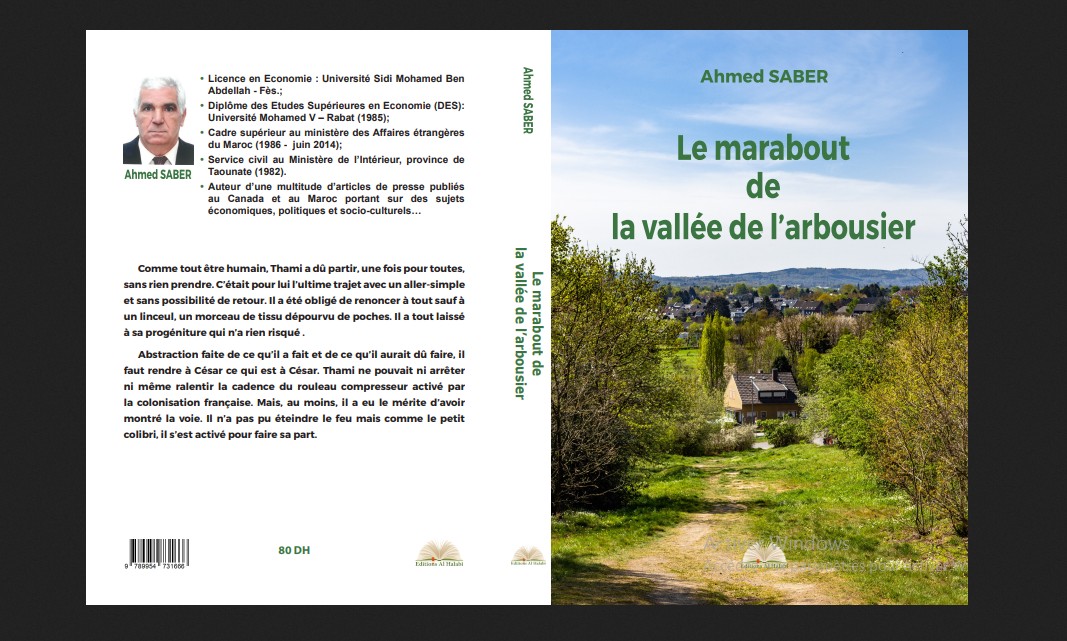Ahmed Saber croyait écrire une histoire banale mais il s’est trouvé à écrire des pages d’Histoire de toute une génération; celle ayant assuré la transition entre le Maroc sous protectorat et le Maroc Nouveau… indépendant! Le voici qui nous guide, à travers ces quelques lignes, vers le fond de roman que nous qualifions « d’historique » :
Durant la période allant de 1912 à 1930, la superficie totale sur laquelle s’étendaient les terres collectives au Maroc a nettement reculé. Au cours des premières années du protectorat, l’appropriation massive des terres collectives a été amorcée dans le cadre de la colonisation foncière officielle et privée. Le statut des terres collectives a été fortement attaqué et devint moribond. La terre collective devint un melk (propriété privée) qui ne dit pas son nom, estima Paul Pascon. La colonisation était devenue une puissante machine pour transformer les terres collectives en propriétés privées.
Quelle que soit l’imprécision des chiffres, on peut affirmer le recul des terres collectives et la montée vertigineuse des propriétés privées. Le passage des terres collectives aux terres privées était nettement plus important que le prélèvement colonial sur les terres collectives. Les notables marocains ruraux de l’époque se ruaient vers la terre pour en faire une propriété privée.
Si l’on observe la répartition des terres selon le statut juridique et la place occupée dans le régime foncier précolonial, on s’aperçoit facilement de la suprématie des terres collectives. A cette époque, les terres « melk- propriété privée» étaient très minoritaires. La propriété privée était rare et confinée dans les zones sédentarisées autour des villes, dans certaines vallées, des oasis et dans certaines plaines marquées par la sédentarisation. Il faut aussi souligner que durant la période précoloniale, la terre n’était pas considérée comme une ressource rare. Le grand problème pour les tribus était le travail humain et animal. Les tribus étaient le plus grand propriétaire des terres agro-sylvo- pastorales, c’est un constat irréfutable et un secret de polichinelle.
A la fin du protectorat (1956), ce rapport quantitatif a été complètement renversé. Les terres « Melk- propriété privée » qui ne représentaient que le 1/5ème (cinquième) des terres cultivables ont pu grimper pour atteindre une proportion de 3/5ème. Au même moment, les terres collectives qui représentaient 70% des terres cultivables ont vu leur part chuter drastiquement pour passer à 15% des terres agricoles exploitables à la fin du protectorat, soit un taux de régression de 55%.
A la même date, les terres attribuées dans le cadre de la colonisation officielle ont grimpé pour atteindre 1 million d’hectares dont la moitié a été prélevée sur les terres des tribus, l’autre moitié provenait des prélèvements sur des terres domaniales et des terres dites « guich ».
Pour faciliter les opérations déclenchées dans le cadre de la colonisation foncière, le protectorat s’est vite attaqué aux terres des tribus, de vastes territoires de culture ou de parcours dont bénéficiaient tous les membres de la tribu. L’étendue de ces terres dépendait du nombre d’habitants de chaque tribu et surtout de sa puissance.
Le protectorat a pu, au fil des ans, arriver à détruire le territoire tribal. Pourtant, la France n’avait pas les mains entièrement libres. Elle avait l’obligation de se soumettre aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit auparavant. Elle devait agir conformément à l’article 2 de la convention de Madrid de 1880, laquelle convention permettait aux étrangers, sans aucune exclusivité, d’acheter librement des terres dans un rayon de 2 kms autour de 8 ports de la côte atlantique du Maroc, et avec l’autorisation préalable du Makhzen (gouvernement) sur le reste du territoire. En vertu des accords signés à l’issue de la conférence de Madrid, les pays européens ont gagné l’entière liberté de posséder des biens et des terres sur l’ensemble du territoire marocain, car dans un rapport fortement déséquilibré en faveur des puissances étrangères, l’autorisation préalable serait une simple formalité, voire une illusion ou tout simplement de la poudre aux yeux . Quand on est faible, on ne peut rien dicter aux autres. On ne peut pas imposer sa volonté chimérique et ses illusions.
La conférence d’Algésiras (1906) a accentué la pression des puissances étrangères sur les terres marocaines en imposant le principe « de la porte ouverte » sur l’économie marocaine. Cette clause consacra l’égalité des chances économiques entre les puissances signataires. En vertu de l’acte d’Algésiras, le Makhzen (gouvernement marocain), « ne put refuser les autorisations d’achat sans motifs légitimes ». En 1912, 80 000 hectares ont été déjà vendus au Gharb et au Chaouia, deux régions agricoles au Maroc.
Il faut rappeler que la question foncière au Maroc a été posée dès les premiers jours de l’instauration du protectorat. Le contrôle des transactions immobilières ont fait l’objet d’une circulaire du Grand Vizir, quelques semaines seulement après la signature du traité de protectorat à Fès, le 30 mars 1012, d’où l’importance qu’accordait la « puissance protectrice » à l’appropriation des terres et surtout à la dislocation/désintégration du régime foncier prévalant à l’époque.
Ce régime qui était encadré par des coutumes ancestrales et le droit musulman était diversifié et très complexe. Deux grandes catégories de propriété dominaient à l’époque à savoir les terres des tribus et les terres collectives. Par contre, les terres des « habous et du Wakf », les immeubles immatriculées, les terres «guich », les terres sans maitres et les terres « Melk » étaient très minoritaires.
Bien que Lyautey, le premier résident général n’ait pas été très favorable à la colonisation de peuplement au Maroc, les autorités coloniales ont mis en place un dispositif juridique ambivalent qui inversa l’équation en décidant de subordonner le local au central et ce, pour détruire le territoire tribal sans protéger convenablement la propriété collective. Cette contradiction flagrante généra une dynamique foncière au profit de certains individus cupides. Par ailleurs, Lyautey qui préférait la colonisation officielle à la colonisation « par le marché » considéra le colon foncier comme « un simple coopérant technique ».
Résultat : En 1930, la colonisation officielle a concerné 270.000 hectares qui ont été attribués à 1.800 colons. Evidemment, on est loin de la colonisation de peuplement. A la même date, la petite colonisation agraire (moyenne de 13 hectares par exploitation) représentait seulement 3,7% des terres attribuées aux colons. En 1956, l’année de l’indépendance, 800.000 hectares étaient une propriété des colons privés, un chiffre qui dépasse, et de loin, la superficie attribuée dans le cadre de la colonisation foncière officielle.
Dans son livre intitulé « Maroc : une économie sous plafond de verre », l’économiste marocain, Najib Akesbi, s’est appuyé sur des statistiques officielles pour essayer de connaitre le sort réservé, après l’indépendance, aux terres exploitées par les colons durant la période du Protectorat. Selon ce chercheur marocain, sur les 1. 017. 000 hectares qui sont tombés dans les escarcelles des colons, on comptait 289. 000 hectares de terres dites de colonisation officielle et 789.000 hectares de colonisation privée. La première catégorie avait été récupérée et pour l’essentiel redistribuée dans le cadre de la réforme agraire au cours des années 1960 et 1970. La deuxième catégorie des terres, qui concernait les exploitations agricoles appartenant aux colons privés, a fait l’objet de deux lois qui interdisaient leur cession à des acheteurs potentiels marocains, sans l’autorisation préalable des autorités compétentes.
Evidemment, ces terres devraient être protégées contre des transactions privées. Or, lorsqu’on lança officiellement l’opération de marocanisation des terres agricoles, en 1973, on s’est aperçu qu’une bonne partie de ces terres a changé de main. Par conséquent, l’Etat n’a pu récupérer que 300.000 hectares sur un total de 789.000 hectares qui étaient officiellement recensés auparavant. Autrement dit, une superficie de 489.000 hectares se serait évaporée sans laisser de trace. Selon toute vraisemblance, elle aurait fait l’objet de transactions frauduleuses et illégales entre colons et clients marocains cupides. La proportion de ces ventes, non autorisées et interdites par deux lois, représenta 62% des terres de la colonisation privée.
Au total, ce sont quelques 600.000 hectares des meilleures terres agricoles du pays qui auraient fait l’objet de transactions commerciales entre des marocains et des colons dans des conditions opaques, déplora Najib Akesbi. Ce qui représente 59% des terres de la colonisation officielle et privée. Une gabegie qui a aggravé la misère et la souffrance des milliers de paysans marocains pauvres qui vivaient dans la précarité extrême !!!!.
Le manque à gagner pour l’Etat et pour les paysans démunis qui auraient bénéficié de la réforme agraire est énorme. Ce qui devrait amener les autorités de l’époque à diligenter des enquêtes indépendantes et traduire les coupables devant la justice. L’on devrait savoir les bénéficiaires de ces transactions interdites par la loi et dans quelles conditions on a pu les conclure. Les dates des opérations d’achat-vente entre marocains et colons privés pourraient justifier certaines transactions mais ne pouvaient pas éluder l’existence d’un délit d’initié apparent et indéniable. L’on sait aussi que les terres récupérées en 1973 ont été confiées à deux sociétés de l’Etat pour assurer la continuité de l’exploitation. Il s’agit de la SODEA (société de développement agricole) et la SOGETA (société de gestion des terres agricoles). Ces deux sociétés ont été liquidées en 2005.
Bien avant Najib Akesbi, le politologue français Rémy Leveau a publié, en 1976, un intéressant ouvrage intitulé « le fellah marocain défenseur du trône », dans lequel il a analysé les relations, mutuellement avantageuses, entre les notables ruraux et l’administration coloniale durant le protectorat. Selon Mr Leveau, un enseignant universitaire qui était aussi conseiller juridique au cabinet du ministre marocain de l’Intérieur (1968- 1974), à la fin du protectorat, le monde rural qui représentait 80% de la population totale du Maroc n’était administré que par quelques centaines de fonctionnaires français civils ou militaires. Dispersés à travers tout le territoire marocain, ces fonctionnaires étaient assistés par une toute petite poignée de commis marocains, mais ultra-protégés par quelques moukhaznis (éléments des forces auxiliaires), dotés d’un armement très vétuste.
Par contre, à Rabat, les grandes directions techniques donnaient l’impression d’un système bureaucratique imposant par le nombre et l’efficacité des agents. Dans les campagnes, une multitude d’agents marocains dont le commandement a été calqué sur le système hiérarchique tribal avaient pour mission de relayer l’action des officiers des affaires indigènes et de contrôler la population. Sans la contribution déterminante et l’action sur le terrain de l’élite et des notables ruraux, et sans le consentement/résignation de la population, la machine administrative coloniale tournerait à vide. Ces auxiliaires locaux avaient aussi pour tâche de renseigner et d’exécuter les décisions de l’administration française.
Pourtant, ces auxiliaires locaux ne coûtaient presque rien au pouvoir central. L’administration coloniale ne leur versait aucun salaire, mais elle n’avait pas à construire et à entretenir des locaux administratifs pour ces auxiliaires pour la simple raison que leur maison en tenait lieu. En contrepartie, les administrateurs français, qui fermaient les yeux et se bouchaient les oreilles, encourageaient la corruption et la sinécure. On les laissait prélever leur part de l’impôt rural et on tolérait quelques exactions supplémentaires. Ainsi, ces auxiliaires locaux auraient pu mettre la main sur des milliers d’hectares, au détriment des pauvres paysans qui en avaient vraiment besoin pour s’extirper des griffes de la pauvreté extrême.
C’était le lancement d’un douloureux processus qui a aggravé et exacerbé la stratification sociale dans le monde rural en permettant l’apparition d’au moins deux classes sociales (les propriétaires et les non-propriétaires des moyens de production). Les paysans sans terre et même les petits propriétaires vivaient sous la domination des grands propriétaires fonciers, des féodaux marocains qui ont pu constituer, au fil des ans, une classe hégémonique qui faisait la pluie et le beau temps dans la zone rurale au Maroc colonial et même après l’indépendance.
Evidemment, la France encourageait tacitement toute action qui visait la destruction des structures socio-économiques « archaïques », qui bloqueraient l’émergence des signes avant-coureurs du système capitaliste, un système socio-économique fondamentalement basé sur le triptyque : prolétariat, capital, libre entreprise, en plus, bien sûr, de la concurrence loyale. La désagrégation progressive du patrimoine foncier tribal qui dominait à l’époque précolonial était l’un des objectifs stratégiques, mais non avoués, de l’administration coloniale. C’est pourquoi, les autorités coloniales toléraient la prébende, les exactions, les spoliations et l’accaparement illégal des terres par certains notables véreux mais dociles, et qui se sont montrés très coopératifs. Evidemment, les autorités coloniales françaises n’ont fermé qu’un seul œil, l’autre restait ouvert pour alerter et se prémunir contre les abus qui pourraient priver la France des meilleures terres à attribuer aux colons dans le cadre de la colonisation foncière officielle. Les autorités coloniales avaient totalement raison, car en politique, il faut toujours « garder un œil ouvert pour surveiller les amis avant les ennemis ». Ce qui donne raison à l’ancien président ivoirien, Félix-Houphouët-Boigny qui a dit : « en politique et comme les crocodiles, je dors en gardant un œil ouvert, car j’ai plus peur de mes amis que de mes ennemis ». Bien avant Félix Houphouët-Boigny, les fonctionnaires français affectés au Maroc durant l’époque coloniale, et qui n’auraient, peut-être, jamais connu ce président ivoirien (1960- 1993) ont agi conformément à l’esprit de cette citation.
Thami, le personnage principal du roman, était un pauvre paysan frustré. Il travaillait beaucoup pour des résultats dérisoires qui ne lui permettaient pas de s’enrichir comme il le souhaitait du fond du cœur. Ses récoltes ne lui permettaient pas de s’émanciper et de gravir l’échelle sociale. Lors de ses nombreux voyages à Fès, Séfrou et Labhalil (un petit village au Sud de Fès), Thami remarquait amèrement des mutations brusques dans les statuts juridiques de certaines terres. Ce qui le faisait souffrir. En quelques années seulement, le paysage agricole a complètement changé. De vastes zones de pâturages, et même des bosquets, ont brusquement disparu du paysage pour céder la place à des exploitations privées.
Choqué, Thami chercha vainement à comprendre comment on aurait pu faire pour s’approprier et privatiser ces terres qui faisaient partie, autrefois, des terres collectives qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Après des mois de réflexion, Thami a pu finalement comprendre la signification réelle de la colonisation foncière officielle et le stratagème qui aurait été utilisé par certains marocains futés et opportunistes, pour s’accaparer des terres fertiles. Furieux, mais fortement convaincu de la pertinence de son analyse, Thami décida d’agir pour entrer dans le club des courageux, des intelligents et des malins. Car, il estima que seuls ces derniers pourraient s’émanciper et s’enrichir, le plus souvent par des actions interlopes.
Pour Thami, un agriculteur de père en fils, la seule voie qui pourrait lui permettre de réaliser son rêve et de s’émanciper socialement est l’appropriation d’un terrain agricole sans maitre, même en agissant dans l’illégalité. Ce qui lui offrit l’occasion de s’enrichir tout en luttant, à sa manière, contre la colonisation foncière officielle ou privée et les abus des notables locaux. Pour Thami, il était temps de se réveiller. Se confiner dans un rôle de spectateur passif ou nonchalant, se complaire dans la pauvreté et se vautrer dans la boue n’est pas une vie, c’est l’enfer. Pour toutes ces raisons, Thami décida d’agir pour arracher les moyens nécessaires pour vivre dans la dignité dans son bled.
Pour atteindre cet objectif, Thami estima que le courage, la ruse, la forte détermination et l’action sur le terrain seraient les principaux facteurs de réussite sur une terre soumise à une occupation étrangère. Pour lui, seuls qui ont osé agir ont pu s’émanciper et s’enrichir. Ceux qui ne font rien, n’ont rien. Les pleutres sans ambition restent figés, ils demeurent là où ils sont, car ils considèrent la pauvreté comme une fatalité. Pourtant, la pauvreté n’a jamais été une fatalité, plusieurs personnes se sont enrichies en travaillant avec acharnement et abnégation, et en agissant au bon moment avec courage et sagesse. Ceux qui ne risquent rien n’auront rien : c’est la morale de l’histoire qu’on peut déduire de la lecture intégrale de ce roman.
*******
Définitions de quelques termes :
– LeGrand Vizir : le véritable chef du gouvernement à l’époque
-Terres collectives : sont des terres de culture ou de parcours, propriété des collectivités ethniques (tribus, fractions de tribus, douars ou autres groupements dans une zone rurale) qui ont un droit d’usufruit et de jouissance. Sur le plan juridique, ces terres sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
-Terres des tribus : propriété d’une tribu. Les « terres des tribus » est un terme plus large qui se réfère à un vaste territoire et non à une ethnie ou à une origine commune…. Elles ont été principalement placées sous le même régime foncier que les terres collectives, régies par le dahir du 27 avril 1919. Les terres collectives appartiennent à une communauté ethnique et non à des individus.
– Terres « Melk » : propriété privée, régie et encadrée par le droit musulman et le rite malékite
- Terres Guich : terres que l’Etat (le Makhzen à l’époque) avait concédées en jouissance, uniquement, à des tribus en contrepartie d’un service rendu, à caractère militaire;
- Terres Habous : les biens habous sont des biens, généralement des biens immeubles, offerts gracieusement par des individus au profit d’une œuvre pieuse, sociale ou charitable. L’usufruit des biens habous est cédé à perpétuité. Ces biens sont placés sous le contrôle du ministère des Habous et des affaires islamiques;
- Terres Wakf : en islam, le Wakf ou Waqf est une donation d’usufruit, une donation inaliénable de biens faite par un particulier à perpétuité pour financer des opérations charitables ou religieuses.